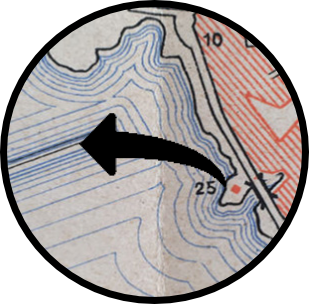Le linguiste franco-syrien Émile Benvéniste a écrit un article remarquable sur cette voie verbale médiane intitulé « L’actif et le moyen dans le verbe » (1950) : tentons d’en détailler l’argument. Alors que le français ne possède que deux diathèses verbales (l’actif et le passif), le grec connaît en effet un mode intermédiaire qui pointe vers l’expérience dont nous parlons : celle d’une activité qui se retourne en passivité, d’une activité dont le sujet serait à la fois l’agent et le patient. En français, c’est de deux choses l’une : soit l’on est actif·ve, auquel cas l’activité que l’on fait va de nous en direction du monde (par exemple, « je parle », « je porte », « je pousse », « je tire ») ; soit l’on est passif·ve, auquel cas nous ne sommes pas les sujets mais les objets de l’activité (« je suis porté·e », « je suis tiré·e »). Comme on le voit, on peut passer facilement de l’un à l’autre par l’intermédiaire de l’auxiliaire être, mais on ne peut pas dire d’un seul verbe et d’un seul coup : je porte et je suis portée, je tire et je suis tirée. C’est soit l’un, soit l’autre.
Pourtant il y a bien des activités où non seulement je fais mais en même temps je subis. Par exemple toucher. Toucher est une très belle et très étrange activité où en un sens, vous n’avez pas le choix : pour toucher (à la voie active), vous devez en même temps être touché·e (à la voie passive). Vous tenez en ce moment un livre dans vos mains : vous le touchez, c’est certain. Mais dans le même temps et inévitablement, en retour, vous êtes touché·e par lui. En français, notre verbe toucher se dit à l’actif, si bien qu’il nous donne l’illusion d’une sorte de mouvement univoque : comme si toucher était un mouvement qui n’allait que de nous à l’objet touché. Mais le grec, bien plus fin sur ce point, parle du toucher au moyen : il dit haptomai (avec la désinence -omai, qui indique le moyen) et non pas hapto (avec la désinence -o, qui indique l’actif, et qui veut dire : « nouer des lacets » ou « mettre en contact », mais pas « toucher »). Pourquoi haptomai, pourquoi la voie médiane ? Parce que toucher n’est jamais un geste de pure action, parce que pour toucher, je ne peux pas me contenter d’aller vers l’objet que je touche, il faut aussi que je laisse l’objet venir à moi, il faut que je me laisse affecter par le toucher. Voilà ce que nous suggère la voie moyenne du verbe haptomai : je ne peux toucher sans être touché·e en retour.
Il y a de nombreuses actions qui ne se disent en grec qu’au moyen : naître, mourir, suivre ou épouser un mouvement, décider, croître, jouir, voler. En parcourant toutes ces activités, on peut leur trouver un point commun : dans le moyen, le sujet de l’activité est en même temps celui à qui l’activité arrive. Autrement dit, dans le moyen, je suis à la fois l’agent·e et le site ou le lieu d’aboutissement de mon action
Et même, c’est parfois plus fort : dans le moyen, ce n’est pas seulement que l’activité que je fais arrive en moi ; c’est plutôt que l’activité que je fais est aussi l’activité qui me fait ; ce que je fais est ce par quoi j’arrive. Ainsi de la naissance. La naissance n’est ni quelque chose que l’on fait, ni quelque chose qui nous arrive seulement. Elle est un événement par lequel nous arrivons : à la fois, personne d’autre que moi ne pourrait naître à ma place, et dans le même temps, on ne peut pas vraiment dire que ce soit moi qui naisse, dans la mesure où « moi » est au bout de ma naissance, son terminus, et non son point de départ. La même chose pourrait être dite de l’activité de suivre ou d’épouser un mouvement : en un sens, personne d’autre que moi ne fait ce mouvement (c’est bien moi qui saisis la vague quand je nage, c’est bien moi qui suis les sinuosités de la route quand je cours sur elle) ; mais en un autre sens, ce n’est pas moi qui en décide, puisque le mouvement se donne à moi de l’extérieur, et c’est bien plutôt la vague et la route qui me mouvementent.
Voilà en somme ce qu’indique la voie médiane : naître, mourir, décider, voler, épouser un mouvement, ce n’est pas seulement être le siège de mouvements qui sont les nôtres, c’est aussi faire l’expérience limite d’être à la fois productrice et produite, agente et site de l’action, bougeant et bougée.Emma Bigé « Mouvementements »
06 23 01 09 96
matthieu.gaudeau@orange.fr