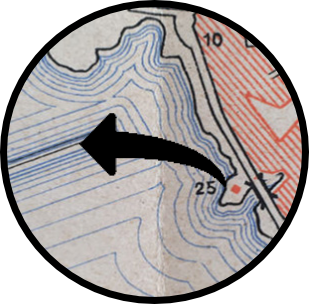Je peux au moins noter un fait qui continue de me frapper : c’est le fait que les muscles qui ont pour fonction, à l’âge adulte, de « gérer » la gravité, sont les mêmes muscles qui, chez le nourrisson, ont pour fonction de gérer la relation à l’autre. Autrement dit, le dispositif musculaire et neurologique qui nous permet de « faire avec la gravité » a pour premier usage, non pas de nous permettre de nous tenir debout (ce que ne fait pas le nourrisson avant longtemps), mais de nous exprimer. Voilà le paradoxe : l’appareil moteur qui nous servira, debout, à composer avec la gravité, est d’abord entraîné par une toute autre négociation, celle de l’accordage affectif du nourrisson avec ses proches. De cette manière, il y a ainsi indissociabilité entre notre manière propre de négocier avec la gravité et notre expressivité.
Avec la question de la gravité, on affronte donc d’emblée une question fondamentale : comment sortir du même ? Comment ne pas se répéter ? Une réponse possible : pour sortir du même, on ne peut pas se cantonner à éviter de reproduire les mêmes figures ; pour sortir du même, il faut aller questionner notre rapport à la toile de fond gravitaire d’où ses figures se détachent.
En effet, qu’est-ce qui fait notre habitus ? qu’est-ce qui fait notre propension à faire ceci plutôt que cela ? On a beaucoup travaillé, dans les sciences sociales, sur l’habitus, mais on s’est rarement posé la question de son incarnation : où sont conservées nos tendances motrices ? Hé bien, je crois qu’il faut dire que c’est dans la relation à la gravité que nos habitudes s’incarnent.H.Godard dans « Mouvementements » de Emma Bigé
06 23 01 09 96
matthieu.gaudeau@orange.fr