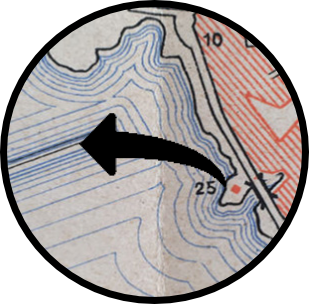Dans la langue, une image des gestes nous est donnée par les verbes : clouer, frapper, pétrir, tourner, tomber, suivre, attendre, paraître, être, avoir, suivre, sauter, mais aussi douter, concevoir, affirmer, nier, vouloir, ne pas vouloir, imaginer aussi, et sentir, et encore aimer, parler, écrire, écouter, toucher, regarder.
Derrière chacun de ces verbes, il n’y a pas seulement une activité : il y a aussi une manière de faire paraître le monde. Donnez-moi un marteau, je ne verrai plus que des clous. Invitez-moi à sauter, les surfaces autour de moi m’apparaîtront en fonction de leur degré de rebond. Laissez-moi écrire et le monde autour de moi reculera à la faveur du monde plat de la feuille et des mots. Tous ces verbes, qu’ils soient « d’action » ou « d’état » comme dit mal la grammaire française, sont invariablement aussi des verbes « de perception ». Le geste (ou le verbe) nomme l’indissociabilité de l’agir, de l’être et du sentir.
Il « fait sens », comme Lucia Angelino le dit en prenant l’anglicisme au pied de la lettre : en lui, se fabrique le sens, c’est-à-dire que se tissent le sentir et le faire qu’il déploie. C’est ainsi comme source d’expérience, à la fois proprioceptive (la qualité dynamique du geste vécu) et extéroceptive (la qualité dynamique du monde découvert par lui), qu’on peut envisager le geste. La chose est difficile à penser en raison d’une pente naturelle des langues indo-européennes, où les verbes pris isolément ne portent de marqueurs que des sujets. Quoi qu’on fasse, quoi qu’on pense, en effet, nos verbes se conjuguent en fonction de leurs sujets, pas de leurs objets. Pourtant te toucher toi et me toucher moi, toucher ce siège et toucher cette vitre diffèrent : ce ne sont pas les mêmes touchers. Il faudrait donc nous habituer à penser autrement nos gestes, à penser autrement nos verbes, de telle sorte que le faire, l’être et le percevoir y soient indissociables, que le sujet et l’objet y soient solidairement impliqués par l’action.
Les gestes sont des manières humaines d’habiter le monde (y agir, en être, le percevoir) par le mouvement. Tel est du moins l’axiome de la phénoménologie des gestes de Vilém Flusser selon lequel « on est dans le monde sous la forme de ses gestes, et en principe tout changement du Dasein est lisible dans le changement de ses gestes. »
Emma Bigé
https://www.pourunatlasdesfigures.net/element/note-sur-le-concept-de-geste
« La structure corporelle, qui est constituée du corps en tant que matière et peut donner lieu à un ensemble d’interventions comme l’osthéopathie, le rolfing, la kinésithérapie, etc., les techniques manuelles dans leur ensemble. L’économie de cette structure est de l’ordre de la mécanique newtonienne et joue sur la spatialité et la plasticité des éléments corporels.
La structure kinésique, l’ensemble des coordinations, des musicalités, des habitus gestuels, qui forment une mémoire qui définit la manière propre à chacun de se mouvoir. Il s’agit d’une économie neuro-physiologique qui joue sur l’espace et la temporalité du mouvement s’appuyant sur un schéma corporel de référence. Un ensemble de techniques du corps trouvent là leur efficacité première, comme celles de Feldenkrais, Mathias Alexander, l’idéokinésis, etc.
La structure esthésique, celle du mouvement des perceptions forme chez chacun un mode de percevoir singulier qui tend à la formation d’une image du corps dans une économie esthétique. Ces grilles de lectures, ces matrices de la sensibilité qui se constituent dans l’histoire, le langage et la culture propres à chacun forment une mémoire radicale de notre rapport au monde. L’atelier de danse, d’improvisation, les arts en général, de nombreuses techniques du corps viennent questionner cette mémoire.
La structure symbolique, le sens, qui est le terrain de la psychologie, de l’économie libidinale du langage, forme un champ qui donne aussi lieu à une autre entrée de l’image du corps, celle qui touche à l’inconscient. »
Hubert Godard