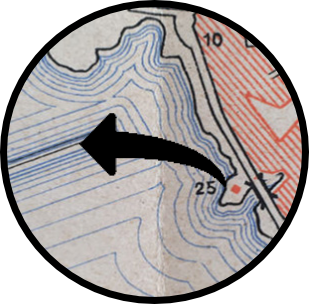J.Damian
M.Bouvier
Le langage fonctionne donc ici comme « prothèse » du corps sensible, par lequel il est « équipé » c’est-à-dire « enrichi de nouvelles sensibilités envers le monde ». J. Damian
« Pour fonder sa thèse d’un imaginaire radical, à savoir un imaginaire enraciné dans la sensation, le philosophe Michel Bernard postule que l’imaginaire n’a rien d’une fonction psychique adventices au corps vécu, mais, bien au contraire, « il habite le cœur même du sentir », et que c’est à cette racine qui puise ses pouvoirs de simulation. En vertu de la réversibilité du senti du sentant, que la phénoménologie Merleau-Pontienne a décrit comme un chiasme, Bernard nous rappelle que tout sentir et aussitôt ressenti, dédoubler par une auto-affection qui fait surgir au sein même de la chair ce qu’il appelle « un reflet virtuel » de la sensation, son « ombre portée » ou encore un « simulacre d’elle-même porteur d’une certaine jouissance »
De son côté, le philosophe Jean Clam parle d’une « épellation du sentir » pour décrire cette articulation profonde du sentir et du dire10. Dans les dimensions les plus basales du corps vécu, les événements sensoriels se déploient suivant une épellation du senti interne qui fait paraître une conscience de l’événement : ça parle en moi. Cette épellation foncière du sentir est évidemment loin de formuler une quelconque proposition signifiante, mais elle exprime déjà, au sein des inflexions organismiques, une « energeia de l’effet de sens » : « au fondement du phénomène du dire se trouve l’articulation et son déroulement, c’est-à-dire cet étirement membrant du sens le long d’un processus articulatoire qui fait advenir la chose. »
Ainsi, parler d’une énonciation ou d’une épellation du sentir, c’est indiquer qu’il y a un certain phrasé du vécu sensoriel, par lequel le sentir est prononcé, c’est-à-dire à la fois accentué, rythmé, détaillé et articulé. Si le sentir semble déjà énoncer un dire dans la chair, l’inverse est tout aussi vrai, en vertu des structures chiasmatiques de la perception, qui réfléchissent le senti sur le sentant : ainsi, tout dire est également capable d’émuler un sentir dans le corps propre.Tournures impersonnelles et débrayages actantiels
Pour induire, il faut suggérer. C’est pourquoi les pédagogues du sentir usent volontiers (et abusent parfois) d’une certaine politesse, en enrobant d’atténuateurs leurs propositions (« peut-être pouvez-vous imaginer que… ; quand vous le souhaiterez, je vous invite à … ») de sorte que le sujet se sente libre de penser qu’il reste à l’initiative de son expérience. Afin de faire varier les agentivités, l’enseignant·e peut aussi panacher les modes verbaux (impératif, indicatif, conditionnel…). Chaque mode verbal a ses avantages et ses inconvénients. Des propositions formulées à l’impératif (« sentez, marchez, soulevez… ») ont l’avantage de pousser spontanément à l’agir, mais c’est au risque que les schémas habituels soient automatiquement recrutés. C’est pourquoi il est parfois avantageux, pour favoriser un débrayage actantiel, d’utiliser des tournures impersonnelles. C’est ainsi, par exemple, que dans son enseignement de la small dance17, le danseur Steve Paxton appelle un relâchement du bassin en disant : « les omoplates tombent dans le dos, relâchant les intestins dans le bassin ».
Ruses
De façon plus radicale encore, la simulation imaginaire est capable de susciter un gain de motricité dans certaines zones de la musculature profonde réputées inaccessibles à la commande corticale. On en veut pour exemple un motif tiré d’une leçon de la méthode Feldenkrais prodiguée par le pédagogue François Combeau20. Dans cette leçon, qui porte sur la mobilité du rachis cervical (un lieu nodal pour les tensions neuromusculaires), vous êtes allongés au sol, et l’enseignant vous invite à faire rouler délicatement votre tête, d’un côté puis de l’autre. Dans une première phase de l’exercice, vous êtes invités à porter une attention millimétrée sur les mouvements de rotation de votre nuque : ces mouvements sont-ils fluides ou bien heurtés, saccadés ? Afin de ne pas laisser votre attention s’appesantir sur les roulements mécaniques de vos vertèbres, l’enseignant vous propose bientôt une image : visualisez la « toute petite trace » que laisse sur le sol l’arrière de votre crâne lorsqu’il roule. « Faites en sorte que cette trace soit la plus légère et la plus douce possible », suggère-t-il, appliquez-vous à ce que son dessin soit « beau, sans à-coups, sans incertitude ». « Imaginez maintenant que vous roulez votre tête sur un tapis musical », dit Combeau. Ce tapis musical vous permet d’entendre la courbe de votre mouvement : est-il staccato, marcato, rubato ou legato ? En vous intéressant aux images de sensations que vous proposent les images de la trace ou du tapis musical, peut-être sentez-vous que votre tête roule déjà de façon plus fluide ?
Mais la ruse va plus loin. On vous invite ensuite à laisser votre tête immobile, reposée, et on vous propose maintenant de décrire le même mouvement de rotation, mais avec vos seuls globes oculaires. Les mouvements de vos yeux sont-ils fluides, ou bien heurtés ? Imaginez qu’un pinceau de calligraphie est virtuellement attaché à vos yeux. Ce pinceau est gorgé d’encre de chine, et va dessiner la trace (« infiniment légère », dit Combeau) de votre mouvement oculaire. Observez les beaux pleins et déliés que trace ce pinceau, la façon délicate qu’il a de prendre les virages, sans écraser les poils, sans laisser de tâche.
Vous commencez sans doute à le réaliser, un débrayage à trois bandes est en train de produire ses effets de relâchement sur votre rachis cervical, de façon inconsciente, et alors même que votre nuque est au repos. Tandis que vous vous intéressez à suivre les pleins et les déliés de votre pinceau, les mouvements de vos yeux activent les nombreux couplages neuromusculaires qui relient les muscles extrinsèques des globes oculaires au rachis cervical. En effet, il est avéré que l’activité neuromotrice de la vergence oculaire est profondément liée aux faisceaux neuromoteurs de la nuque et de la musculature axiale du tronc, ces couplages servant à assurer les mouvements réflexes de rotation du tronc et de la nuque qui accompagnent la poursuite visuelle21. C’est donc en jouant avec l’extrémité la plus fine de ce couplage neuromoteur, au niveau de la poursuite visuelle elle-même, que l’on va induire, sans plus y toucher, un mouvementement profond dans la colonne cervicale.A la voie médiane
Avec leurs effets de ruse, les consignes que l’on vient de décrire ont pour enjeu la recherche d’un débrayage actanciel qui permette de médier les agentivités de l’effort et de l’attention. C’est aussi pour cette raison que les pédagogues du mouvement ont fréquemment recours aux formules chiasmatiques, qui combinent un agir à la voix active et à la voix passive. « Dans la marche, vous pouvez sentir une différence dans votre pas quand, tantôt, vos pieds touchent le sol, et quand, tantôt, ils sont touchés par le sol ». Pour un même mouvement, comme celui d’allonger les deux mains vers l’avant, l’expérience tonique et affective sera toute différente si l’on vous propose, à la voie active, de « pousser un ballon dans l’eau », et si l’on vous suggère, à la voie passive, que « vos mains sont soulevées par le vent ». Les passibilités au mouvement offertes par de telles consignes s’étoffent encore lorsqu’il est fait usage d’équivoques ou de paradoxes, comme le fait souvent le chorégraphe et pédagogue Loïc Touzé :
« Quand j’inspire, le monde expire et quand j’expire, le monde inspire. »
« Je m’approche de ce dont je m’éloigne / je m’éloigne de ce dont je m’approche. »
« Je suis vu par ce que je vois / ce qui me voit regarde aussi ce que je ne vois pas, je suis vu par un espace voyant… »Avec ces formules, le sentir et l’agir sont appelés sur un mode actantiel que la philosophe Emma Bigé propose d’appeler la voie moyenne, un concept qu’elle déduit du mode verbal de la diathèse moyenne24. La diathèse moyenne est un mode verbal assez rare, que l’on trouve dans certaines langues indo-européennes anciennes ; il permet à certains verbes d’indiquer, comme le dit Émile Benveniste, « un procès dont le sujet est le siège (…). Le sujet est centre en même temps qu’acteur du procès ; il accomplit quelque chose qui s’accomplit en lui. » Par exemple, en grec, des verbes tels que naître (Gignomai), ou jouir (fruor) sont des verbes à la diathèse moyenne, car il s’agit d’événements pour lesquels le sujet est l’agent autant que le patient de son acte. Emma Bigé propose donc une extension de la diathèse moyenne à l’adoption d’une voie moyenne dans le mouvement, une façon d’« effectuer en s’affectant ». Elle en donne pour emblème cette figure qui est au cœur du travail du danseur japonais Ushio Amagatsu : le corps du danseur est à la fois marionnette et marionnettiste, inflexion locale d’un mouvement qui passe à travers lui, dont il est la cause autant que l’effet. À la voie moyenne, le rapport conscient du sujet sentant à ses sensations devient donc, comme le suggère aussi Guillemette Bolens : « un rapport des sensations à un je au datif » : ce n’est pas seulement le sujet qui a des sensations, mais ce sont aussi les sensations qui donnent le sujet à lui-même, comme son propre complément d’objet indirect.
Ainsi, l’usage de la voie moyenne dans les énoncés de guidage favorise une expérience du geste dans laquelle s’estompent les polarisations du sujet et de l’objet, de l’actif et du passif, au profit d’agentivités moins dualistes et plus mésologiques : « il y a en moi des mouvements qui ne sont pas de moi » écrit Emma Bigé « des mouvements qui me précèdent et dont certains m’instituent. » C’est évidemment le cas des mouvements biologiques et physiques qui participent de la vie même de mon corps (respiration, flux, vie microbiotique, gravité terrestre, etc.), mais c’est aussi le cas de mes mouvements intentionnels lorsque je les éprouve de façon médiane, et qu’ils semblent venir à moi, plutôt que de moi. Ainsi, lorsqu’il est vécu à la voie moyenne, le geste dansé est non seulement impersonnalisé, élargi aux forces du milieu, mais il peut aussi se faire l’instaurateur d’existence d’un certain être de la sensation. Michel Bernard suggérait tout à l’heure l’idée que toute sensation impressive se voit doublée d’une projection de simulacres, reflets virtuels ou ombres portées qui en manifestent la pression d’existence dans la chair. Dans l’expérience de la voie moyenne, le sentir déborde tout solipsisme et devient porteur d’une véritable puissance d’altérité, au point que la sensation vécue semble émaner d’un autre que moi, avoir son être et son monde propre.Métaphore
Dans sa définition neurologique, le concept d’émulation participe de la « simulation incarnée », cette disposition du système miroir propre au cortex pré-moteur qui permet de créer, à la simple vision ou projection mentale d’une action motrice, un « fantôme moteur30 » de l’action perçue, ou imaginée. Un « fantôme de fait » peut donc être émulé dans la corporéité par un acte imaginaire de visualisation d’un processus kinesthésique ou proprioceptif. C’est ainsi que certains sportifs de haut niveau peuvent réaliser des entrainements (et du renforcement musculaire) par la simple visualisation des enchaînements moteurs de leur activité. À force de travailler cette idéation kinesthésique ou proprioceptive (ideokinesis), l’émulation de « fantômes de faits » dans la corporéité favorise l’émergence de ce que Basile Doganis appelle « une étrange genesis, genèse ou hétérogenèse [d’une] altérité latente en soi. »
Munir ses yeux d’un pinceau, sentir la gravité comme une douche chaude, être la marionnette et le marionnettiste dans un même mouvement, ces images sont autant de métaphores au sens plein du terme : ce sont des images porteuses d’une simulation incarnée, elles font immédiatement paraître, avec le fantôme de fait, un être de la sensation qui peut devancer, surprendre, et parfois excéder notre intentionnalité.
Si les métaphores peuvent avoir de vrais pouvoirs émulateurs35, leur efficacité a aussi des limites. Comme pour toute figure de style, le pouvoir mobilisateur de la métaphore peut s’éroder avec l’usage, la répétition ou la fixation dans le code (comme c’est le cas pour certaines expressions figurées tombées en catachrèse : au pied du mur, les ailes du navire, en dents de scie, etc.). Pour qu’une métaphore soit réellement porteuse d’une simulation incarnée, il faut, comme le dit Paul Ricoeur, qu’elle soit « vive36 », c’est-à-dire qu’elle insuffle un véritable mouvement poétique à son énoncé, qu’elle en affole le sens, et qu’elle nous oblige à en refaire le geste. L’efficacité symbolique d’une métaphore ne se joue donc pas seulement au niveau paradigmatique (contenus évoqués), mais tout autant sur le niveau syntagmatique (tournures grammaticales). C’est pourquoi, pour avoir une vraie force d’émulation, les inductions poétiques doivent jouer non seulement d’images saisissantes mais aussi de ruses dans leur énonciation : équivoques, ambiguïtés, paradoxes…Paradoxes
Comment répondre à des consignes telles que : « sautez vers le bas » ou « laissez-vous chuter vers le ciel » ? Lorsqu’elles sont aporétiques, c’est-à-dire lorsqu’elles sont manifestement impossibles à réaliser (voire à comprendre), les consignes paradoxales appellent des réponses obliques aux termes mêmes du problème qu’elles posent.
Comme les consignes de Hay, ces paraboles donnent une existence sensible à des phénomènes ordinairement conçus comme idéatifs ou virtuels. Elles ont des propriétés stupéfiantes, au sens psychotropique du terme : « je m’injectais la phrase mon corps assimile la patience au renouveau. Ma chimie corporelle s’en trouvait immédiatement modifiée50 », témoigne Hay. La force d’intrigue poétique de telles consignes est capable d’émuler un véritable pouvoir de voyance somatique. Ainsi, une danseuse « stupéfaite » sait comment consacrer une attention fine aux 53 milliards de cellules qui composent son corps, en même temps qu’à l’unité de celui-ci, et suivant les alignements qu’il trouve partout. Même si l’on peut douter que les 53 milliards de cellules sensibles qui composent le corps humain soient accessibles à l’intéroception, on doit néanmoins reconnaître qu’elles participent de cette « sensibilité primaire que nous sommes », comme le disent Gilles Deleuze et Félix Guattari51. Si nous admettons que nous sommes, dans notre chair, un « composé de sensations », et que nos gestes dansés sont des formes sensibles rapportées à ces sensations, alors nous pouvons nous autoriser de cette sensibilité primaire que nous sommes pour émuler en nous l’hyperbole sensorielle de 53 milliards de cellules semi-autonomes, sentantes et senties.
« Et si l’alignement est partout ? », se demande-t-elle ;
ou bien « je transforme le corps tridimensionnel en un incommensurable ensemble de 53 milliards de cellules, toutes perçues en train de percevoir simultanément. »Matthieu Bouvier « Gestes de parole »